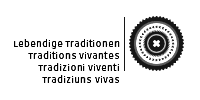*Inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO
Avec ses nombreuses variations et spécificités locales, la saison d’alpage est issue d’une pratique largement attestée depuis la fin du Moyen-Âge. Entre mai et octobre, des bovins, des moutons et des chèvres sont conduits sur des pâturages d’altitude (entre 600 m et 2900 m) pour tirer parti du fourrage supplémentaire. Là, des hommes et des femmes, les alpagistes, gèrent des troupeaux et prennent soin des animaux, travaillent à l’entretien des pâturages, des clôtures et des bâtiments, transforment le lait en fromage et autres produits et accueillent aussi du public. La pratique crée des liens économiques et émotionnels entre la population locale, les alpagistes et les alpages et participe ainsi au maintien de paysages culturels séculaires.
La saison d’alpage a donné naissance à des savoirs et savoir-faire artisanaux nécessaires pour l’entretien des sites et des ustensiles ainsi qu’à une diversité de pratiques sociales. Celles-ci comportent des rites, des costumes, des fêtes calendaires locales telles que l’inalpe (montée), la désalpe (descente) et, selon les régions, la mi-été, ou des manifestations où l’on élit la plus belle vache du troupeau. Ces usages se transmettent dans le cadre familial et par la pratique. Alors que la présence des bêtes en montagne joue un rôle important pour les visiteurs, les fêtes mettant en valeur les pratiques artisanales constituent des moments forts de la vie locale. Depuis deux siècles et demi, les artistes célèbrent l’alpage et le chalet comme des emblèmes d’une vie proche de la nature en littérature, en arts visuels, en musique et sur scène. L’exploitation des alpages avec du bétail maintient ainsi un ensemble de traditions dans une réalité sociale vivante, dans des paysages culturels longuement travaillés, en lien avec des productions alimentaires réputées et reconnues.
Description détaillée
Saison d’alpage (PDF, 345 kB, 27.06.2024)description détaillée
Catégorie
Expressions orales
Pratiques sociales
Artisanat traditionnel
Canton
Contact
Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband
Roth-Stiftung Burgdorf
Interprofession du Gruyère
Musée gruérien